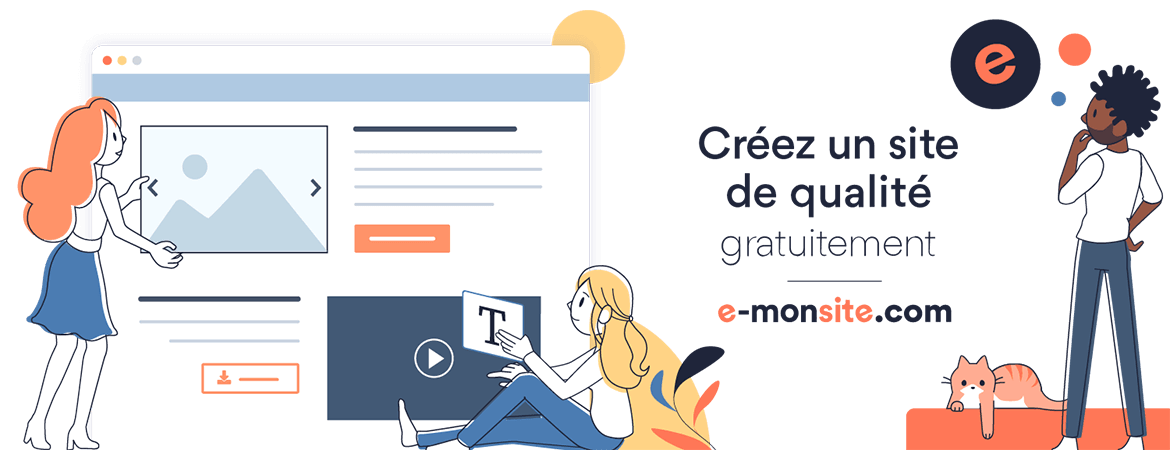Je viens d’un Pays qui n’existe plus
Par Liliane Puzenat
Avant toutes choses, permettez que je fasse une petite remarque sur le terme « RAPATRIEMENT ».
Voilà bientôt 50 ans qu’on nous nomme « Les Rapatriés » alors que, si l’on se réfère au dictionnaire, on s’aperçoit qu’un rapatrié est « une personne ramenée dans son pays d’origine par les soins des autorités officielles ».
Ce qui est loin d’être notre cas !
D’abord, parce que nous avons quitté notre terre d’origine Française pour en rejoindre une autre que nous n’appelions pas la France, mais la Métropole, puisque là-bas nous étions déjà en France, ensuite parce que les soins des autorités officielles, à notre égard, ont été totalement inexistants …
Mais peu importe ce terme inapproprié, car je vous avouerai que, pour la plupart d’entre nous, notre Patrie d’origine étant seulement l’Algérie, nous nous sentons tout simplement exilés, ainsi que le traduit le dictionnaire petit Larousse illustré : « Personne obligée de vivre loin d’un lieu où il aurait aimé être ».
Peut-il y avoir un terme plus exact et plus fidèle que celui-ci ?
Permettez aussi, que je revienne sur la date du 19 mars 1962 qui, soi-disant, aurait marqué la fin de la guerre d’Algérie !
Cela est totalement faux, puisqu’après cette date fatidique, nombre de soldats sont encore morts au combat.
Il y a eu aussi le massacre du 26 mars 1962, à Alger, où, au cours d’une manifestation tout à fait pacifique pour apporter notre aide aux populations de Bab-el-Oued et à laquelle j’assistais avec ma Mère et ma sœur, 60 Européens sont tombés sous le feu nourri de balles Françaises, souvent tirées à bout portant et où, également, 200 autres Européens ont été blessés.
Si j’emploie le terme d’Européens, c’est qu’à cette époque, bien que cette appellation existait déjà bien sûr, on ne nous appelait pas encore Pieds-Noirs.
La France a utilisé ce terme, à notre arrivée en Métropole, pour nous différencier des Français de France.
Et c’est avec plaisir, orgueil, fierté et nostalgie que nous avons adopté ce nom, en souvenir des pionniers qui ont débarqué et construit l’Algérie.
Il y a eu aussi le 5 juillet 1962, à Oran, lors de la fête de l’indépendance, le massacre de 5.000 Européens par le FLN et l’ALN et ainsi que sur tout le territoire, l’enlèvement de 2.000 Européens, dont nous n’avons plus jamais eu aucune nouvelle et dont la France ne s’est jamais inquiétée ….
A cela, je veux ajouter le massacre de plus de 200.000 Harkis et leurs familles, dont le seul crime a été d’aimer, de croire en la France et de combattre aux côtés de cette France qui les a lâchement abandonnés, non sans les avoir, avant cela, désarmés …
A ce sujet, je préfère ne pas m’étendre sur cette tragédie d’un bateau rempli de Harkis qui devait gagner la France et qui a dû débarquer ces derniers, les livrant ainsi aux mains de barbares sanguinaires qui les ont tous égorgés sur le quai d’une ville dont je tairai le nom.
J’en profiterai pour vous préciser que les Algérois, n’ont réclamé de Gaulle que, parce que ce nom a été soufflé à la foule massée sur le Forum d’Alger et prête à accepter n’importe quoi et n’importe qui, pour garder l’ALGERIE FRANCAISE.
Il y avait déjà belle lurette qu’à Paris les tractations avaient eu lieu dans ce but précis et que le nom de de Gaulle circulait dans les plus hautes instances …
Pied-noir de 5ème génération, j’ai eu la chance de voir le jour à Alger, dans une famille de 5 enfants.
Ma mère travaillait à la bonne marche de la maison, à l’éducation de ses enfants et mon père était professeur d’anglais et d’allemand.
Mes ancêtres, originaires de France, étaient, entre autres, de Lyon, de Castres, de Vienne, du département de l’Ain et de celui des Vosges ;
Ils ont travaillé toute leur vie pour mettre ce Pays en valeur et ont participé à sa construction en asséchant les marécages, en le défrichant pour rendre sa noble terre fertile, en éradiquant les maladies, la misère, la pauvreté et en libérant les indigènes du joug des Turcs.
C’est ainsi que nos ancêtres nous ont fait le merveilleux cadeau d’un Pays magnifique, dans lequel nous vivions,
Chrétiens, Juifs et Musulmans, ou Musulmans, Juifs et Chrétiens si vous préférez, côte à côte et sans conflit.
Nous ne cherchions pas à nous fondre les uns aux autres, car chacune de nos communautés était fière de sa spécificité et avait le plus grand respect des autres communautés.
Je vous préciserai d’ailleurs que je n’ai jamais entendu prononcer le mot « racisme » en Algérie.
Nous avions nos coutumes, nos traditions et nous respections celles de nos compatriotes.
Et si nous étions trois communautés principales, il y avait aussi parmi les Juifs et les Chrétiens, des Pieds-Noirs d’origine Italienne, Yougoslave, Portugaise, Espagnole, Mahonnaise, Sicilienne, Maltaise et d’autres encore.
Chacune d’entre elles, apportait ses pierres à l’édifice, par les traditions, les coutumes, les chants, les recettes de cuisine, les plaisanteries ou les souvenirs de leurs anciens.
Enfin, le boulanger d’origine Italienne, le maçon d’origine Portugaise, la couturière d’origine Espagnole, l’épicier Arabe que nous appelions le « Moutchou » ou le « Mozabite », le coiffeur d’origine Sicilienne qui s’appelait souvent « Sauveur », le tailleur Juif ou le droguiste originaire de France composaient cette mosaïque colorée, puissante, enthousiaste, bruyante, tumultueuse, à l’accent prononcé et si caractéristique !
Nous étions un peuple fait d’ouvriers, d’artisans, d’agriculteurs, de cultivateurs, de commerçants, d’enseignants, d’avocats, de notaires, de médecins, de pharmaciens, de petits colons (Ah ces colons ! Véritables boucs émissaires chargés de toutes les accusations mensongères et rendus responsables de tant de maux !), ces colons, disais-je, travaillaient dur la terre, entourés de leurs ouvriers arabes et pieds-noirs, pendant que les épouses des premiers soignaient les femmes et les enfants des seconds et qui, souvent, mangeaient à la table du « patron » et de sa famille.
La poignée de riches colons, certainement moins nombreux, en proportion, que tous les riches de la Métropole, avaient déserté l’Algérie dès le début de la guerre et le peuple que nous formions n’était en rien semblable à ce que les Français de Métropole imaginaient … nous accusant de faire suer le burnous et de vivre comme des pachas !
Maintenant, si les droits civils n’étaient pas les mêmes pour tous, c’était auprès des autorités françaises qu’il fallait faire des réclamations. Eux seuls en portent la responsabilité. Pourquoi d’ailleurs, par souci d’égalité, ces autorités n’ont-elles pas rendu l’arabe obligatoire dans les écoles ?
Enfin, nous menions une vie simple, mais très agréable.
La famille était très importante et le dimanche très régulièrement, nous allions chez nos cousins à Guyotville, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Alger, où, dans leur villa, nous nous retrouvions environ une trentaine.
Il y avait les Mamies, les Mémés, les Papis, les Pépés, les Tatas, les Tontons, les Tantines, les Titounes, les Marraines, les Parrains, etc., etc. ….
Les adultes, dans le salon, refaisaient le monde, jouaient aux cartes ou bien, dehors, s’adonnaient à de célèbres parties de pétanque, ou partaient à la pêche suivant le temps, tandis que nous, les enfants, au nombre d’une vingtaine, nous partions dans la campagne, des journées entières, emportant, dans un panier, notre repas qui consistait en deux tranches de pain imbibées d’huile d’olive et d’ail pilé, de tranches de saucisson et de soubressade ….
En guise de dessert, nous grignotions des « pin-pignons» que nous récupérions dans les pommes de pins ou cueillions dans les champs des plantes aux fleurs jaunes que nous appelions «vinaigrette» et, suivant la saison, dégustions des nèfles, des grenades ou des plaquemines (KAKI), que des arbres généreux offraient à nos yeux émerveillés.
Nous en mangions parfois tant que nous finissions, le soir, par souffrir de douleurs abdominales … et pour rafraîchir notre gosier, nous avions des gargoulettes remplies d’eau que nous suspendions à une branche, afin que le vent les rafraîchisse.
Nos parents n’étaient pas inquiets, car nous ne risquions rien.
Je n’ai jamais entendu parler dans ce Pays d’un crime, d’un enlèvement, d’un viol, ni même d’un vol.
Nous laissions voiture et maison ouvertes et pas une seule porte d’entrée d’immeuble n’était fermée à clef.
Elle restait ouverte nuit et jour, à tous les vents et ce, même pendant les évènements.
Il aura fallu que je vienne en France pour découvrir le système des noms et des sonnettes à l’entrée des immeubles, fermés à double tour !
Parfois aussi, nous faisions des pique-niques monstres dans la forêt de Sidi-Ferruch, de Zéralda ou de Baïnem.
Nous étions 15 ou 20 et chaque maîtresse de maison apportait une spécialité.
Une tchouchouka, une tortilla, une frita, une quiche ou des œufs durs et nous mettions tout cela en commun, après que les adultes se soient rafraîchis d’une bonne rasade d’anisette accompagnée de tramousses, de graines de pastèques séchées et salées et de zitounes.
Sans oublier, au moment des fêtes de Pâques, pour le dessert ou le goûter, la célèbre et délicieuse Mouna», une grosse brioche au sucre et au parfum d’orange qui nous caressait les narines et que nous savourions avec délice.
Lorsque quelques morceaux de celle-ci avaient échappé à la gourmandise des «Gargantua», notre plus grand plaisir était, le lendemain au petit déjeuner, de les déguster, après les avoir trempés dans notre café au lait !
Enfin, quelques années plus tard, nous avons troqué nos balades dans la campagne et nos pique-niques contre les surprises parties (qu’on appelait les bouffas) qui duraient jusqu’au lendemain matin, puisque le couvre-feu nous interdisait de sortir après 21 h 00.
Mais rassurez-vous, en tout bien tout honneur, pas question d’avoir la moindre attitude équivoque !
Le 1er novembre 1954, j’allais avoir 11 ans, lors des premiers attentats dans les gorges de Palestro.
Et c’est ainsi que nous avons passé notre jeunesse à entendre parler de massacres, d’embuscades, de bombes dans nos bus, dans nos cafétéria, dans nos dancings et dans nos cinémas.
Mais on finit par s’habituer au danger et on vit avec, tout en s’horrifiant d’apprendre qu’un nouvel attentat vient de faire des victimes dont on cherche à s’enquérir de suite des identités et en remerciant le Seigneur d’avoir échappé à ce drame.
Le lundi matin parfois, à l’école, une place restait vide. Deux ou trois jours plus tard, nous apprenions que notre camarade de classe, qui était pensionnaire et ne rentrait chez elle qu’en fin de semaine, et toute sa famille, vivant dans une ferme, avaient été assassinées.
Et pourtant, à Alger, comme partout en Algérie, nous continuions à vivre en osmose avec nos frères musulmans.
En classe, j’ai fait tout mon primaire et tout mon secondaire dans une école religieuse et avec des amies musulmanes.
Leïla, Ratibah, Nadia, Djamila, Ouardia, etc., etc. …
La seule différence est qu’elles n’assistaient pas à nos cours de religion et croyez-moi, elles n’ont jamais été offusquées par la vue du crucifix dans les salles de classes, dans le réfectoire ou, pour celles qui étaient pensionnaires, dans les dortoirs ….
Nous-mêmes, trouvions tout à fait normal d’entendre le canon qui annonçait chaque soir, pendant le ramadan, la trêve qui leur permettait enfin de se restaurer.
Je me souviens, de ce moment précis, où un cri joyeux montait de la ville et par lequel les Musulmans saluaient ce moment béni !
Malheureusement, nous n’avons plus été en classe après les évènements du 26 mars 1962, car nous avons compris à cet instant que la France nous lâchait définitivement. Mais jusqu’à ce moment-là je vous avouerai qu’avec des camarades de classe, il nous arrivait de «taper cao», faire l’école buissonnière si vous préférez.
Et où allions-nous pour ne pas nous faire surprendre par nos parents ?
Rue de la Lyre, dans les quartiers arabes, tout près de la casbah.
Nous n’avons jamais eu le moindre problème !
Hélas, après 122 ans de labeur et de quiétude, il aura fallu qu’un vent de folie s’abatte sur l’Algérie avec, pendant 8 ans, la barbarie et la cruauté que l’on sait, répandant la peur dans tous les foyers et le sang dans les villes et les campagnes, par des attentats sordides, aveugles et lâches.
Et pourtant jusqu’à la fin, nous avons cru sauver notre sol natal !
Aussi, lorsque l’O.A.S a voulu, dans un légitime et dernier combat, se dresser face à la politique d’abandon de la France, nous avons cru trouver là, notre sauveur. Mais hélas, il était trop tard et le sort de notre Algérie en était déjà jeté. Le gouvernement Français a rappelé l’Armée Française en Métropole.
En Algérie, le désordre devenait total et le danger à chaque coin de rue. Les murs se couvraient d’inscriptions injurieuses et menaçantes à l’égard des Pieds-Noirs et notamment : « La valise ou le cercueil »…
C’est alors que nous, les Pieds-Noirs, bien que beaucoup de Musulmans nous suppliaient de ne pas quitter l’Algérie et de ne pas les abandonner, nous avons dû partir avec les deux valises auxquelles nous avions droit, en nous disant : «Bon, on va partir quelques jours, le temps que tout se calme, puis nous reviendrons».
Mais hélas, nous ne sommes jamais revenus sur la terre de nos ancêtres qui, certains, ont encore la chance de dormir en paix au sein de cette terre qu’ils ont tant chérie, alors que d’autres, exhumés par des mains barbares, n’ont, pour toute sépulture et pour tout repos, que notre mémoire fidèle et notre reconnaissance éternelle.
En ce 19 juin 1962, avec ma Mère, ma sœur et mes petits frères, j’ai connu l’attente interminable sur les quais d’Alger sous un soleil de plomb. Puis, nous sommes montés dans un bateau et tous, nos yeux pleins de larmes rivés sur Alger, nous avons regardé notre ville disparaître dans une épaisse brume de chaleur, jusqu’à s’en faire fondre les yeux.
La traversée sur le Sidi-Okba fut mouvementée, tant le bateau était surchargé de pauvres gens qui ne cessaient de pleurer, serrant contre eux un bébé, un enfant, un parent, un chien, ou même une cage d’oiseaux.
Nous étions au bord de l’asphyxie, au bord du désespoir, au bord de l’abîme.
C’était l’exode dans toute son horreur !
Arrivés sur les quais de Marseille, nous n’avons pas vu l’ombre d’un comité d’accueil pourtant annoncé.
Non, rien ! Ah si, j’oubliais … Quelques ouvriers, au moment où nous nous sommes croisés, ont craché dans notre direction, en bredouillant quelque insulte …
Ne trouvant aucune chambre d’hôtel pour nous accueillir, je me souviens que, ma sœur, mes petits frères et moi, nous sommes installés sur le dernier banc qui, par chance, restait inoccupé, place de la Bourse. Tout autour de nous, une multitude de Pieds-Noirs hagards, désemparés, flanqués de leurs deux valises, attendaient, comme nous, un je ne sais quoi, s’épongeant le front et essuyant d’un geste las, des larmes bien amères !
Maman était partie dans l’espoir de nous trouver un toit pour y passer la nuit.
Et le miracle s’est produit.
Nous avons été recueillis dans la sacristie d’un temple Protestant situé boulevard de la Libération.
Bien souvent, dans mes prières, je remercie ce charitable Pasteur qui n’a pas eu peur de s’encombrer de ces «sales Pieds-Noirs», comme on nous a longtemps appelés ….
Nous y avons passé une semaine, le temps de réaliser notre infortune, puis, suivant les conseils de ce «cher maire de Marseille», Gaston Defferre qui exigeait que «les Pieds-Noirs aillent se réadapter ailleurs ou qu’on les balance à la mer», nous sommes montés sur Lyon.
Quelques hommes politiques ont voulu jouer les « cassandre » et prédisaient que les Pieds-Noirs, ces voyous, en bandes organisées, allaient commettre des méfaits dans toutes les régions de France.
Il nous aura fallu trois mois pour obtenir un appartement dans une H.L.M.
Nous n’avions aucun meuble, mais, l’automne étant au rendez-vous, nous étions heureux d’avoir enfin un toit !
Dans cette H.L.M, il n’y avait que des Pieds-Noirs.
C’était pour nous une consolation, ils devenaient un peu notre famille, puisque nous étions tous disséminés aux quatre coins de l’hexagone, sans famille et sans amis !
Mais je regrette une chose, c’est qu’une fois de plus, le gouvernement se soit fourvoyé !
Pourquoi n’a-t-il pas installé les Harkis avec nous, plutôt que de les parquer comme des pestiférés ?
Avec eux, nous nous serions sentis encore un peu chez nous …
Aux alentours, les Métropolitains ne nous adressaient pas la parole et à l’école de secrétariat où j’ai continué mes études, personne n’a compris pourquoi j’étais blonde aux yeux verts …
Ainsi, les Pieds-Noirs, à force de courage et faisant fi de toutes les accusations dont ils ont été victimes et auxquelles ils n’ont jamais pu répondre, parce que muselés par la classe politique et les médias, ont réussi, petit à petit à se refaire une vie.
Mais, devant l’ampleur de la tâche et le chagrin du partir, nombreux sont ceux qui ont mis fin à leurs jours. Nous sommes restés les Africains revenus de loin, après avoir laissé derrière nous, un pays superbe aux infrastructures terrestres et aériennes étonnantes, aux villages «de l’intérieur» inondés de soleil et bordés de champs de vignes, de céréales et d’arbres fruitiers, aux villes fières aussi bien de leurs immeubles Haussmanniens, que de leurs petites maisons, de leurs bâtiments imposants de style oriental, de leurs parcs odorants et de leurs plages caressées par une mer intensément bleue, jusqu’à se confondre avec le ciel. Enfin, si l’accueil et l’installation en France ont été très douloureux, le départ de mon Algérie, de mon Pays Natal aura été infiniment cruel.
Alger me manque !
Alger est resté intact dans mon cœur. Ma Ville Natale sera, pour toujours, mon Amour, ma Douleur et mon plus beau Souvenir.
Je n’oublierai jamais ma Terre d’Algérie, sous l’infini d’un ciel bleu, dans sa beauté, sa blancheur et son soleil …
Et la Nostalgérie m’étreindra jusqu’à mon dernier soupir.
Aujourd’hui si l’on me demande d’où je viens, je réponds comme dans la chanson :
« Je viens d’un Pays qui n’existe plus »
LILIANE PUZENAT
Fait à Aix-en-Provence le 22 avril 2011
 Je suis désolé de vous contredire lorsque vous dites que le mot racisme n'existait pas; Il est vrai que les indigénes comme vous les appelez n'osaient pas lever la téte ; les esclaves noirs d'amerique aussi ignoraient ce que racisme voulait dire . Mais déja dans l'assemblée nationale il y avait 2 colleges ; Alors il n'y avait pas de racisme car ce mot était trop faible et ne pouvait reproduire les souffrances de ces indigénes . lorsque on lit vos ecrits il me semble que ces étres (dont faisait partie mes parents) n'étaient que des ombres qui rasaient les murs et qui devaient presque s'excuser d'éxister . d'ailleurs existaient ils vraiment à vos yeux?
Je suis désolé de vous contredire lorsque vous dites que le mot racisme n'existait pas; Il est vrai que les indigénes comme vous les appelez n'osaient pas lever la téte ; les esclaves noirs d'amerique aussi ignoraient ce que racisme voulait dire . Mais déja dans l'assemblée nationale il y avait 2 colleges ; Alors il n'y avait pas de racisme car ce mot était trop faible et ne pouvait reproduire les souffrances de ces indigénes . lorsque on lit vos ecrits il me semble que ces étres (dont faisait partie mes parents) n'étaient que des ombres qui rasaient les murs et qui devaient presque s'excuser d'éxister . d'ailleurs existaient ils vraiment à vos yeux?